Joseph Conrad au coeur des ténèbres
9782253167440
Joseph Conrad – Le cœur des ténèbres | LGF/Le livre de poche
–
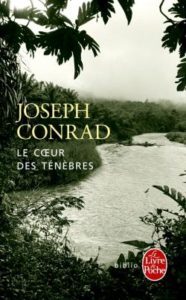 « Marlow n’était pas typique (mis à part sa tendance à fabuler), et pour lui, le sens d’un épisode n’était pas au fond, comme la vérité dans un puits, mais autour : il enveloppait le conte qui le révélait simplement comme une incandescence révèle une vapeur, semblable à ces halos brumeux que rend parfois visible la réverbération de la lune. » (p. 26)
« Marlow n’était pas typique (mis à part sa tendance à fabuler), et pour lui, le sens d’un épisode n’était pas au fond, comme la vérité dans un puits, mais autour : il enveloppait le conte qui le révélait simplement comme une incandescence révèle une vapeur, semblable à ces halos brumeux que rend parfois visible la réverbération de la lune. » (p. 26)
C’est dans cette configuration énigmatique que s’insinue le troublant récit de Joseph Conrad. Si les sens circonvoluent sur l’orbite d’un point aveugle – aveuglant? – de l’humanité, embarqué sur le bateau à vapeur de cette enquête existentielle fluviale, nous nous trouvons devoir affronter néanmoins le fond du puits. C’est Le cœur des ténèbres.
De 1885 à 1908, Léopold II exerça à titre privé le contrôle du mal nommé État indépendant du Congo. Parangon de l’esprit colonial le plus résolu, le roi des Belges se trouva fort intéressé par le commerce des nombreuses ressources du nouveau territoire, spécialement du caoutchouc et de l’ivoire. Ayant tiré de son expérience congolaise des considérations vraisemblablement dérangeantes, Conrad, fort d’une longue carrière maritime, institue son roman sur l’arrête d’une frontière. Du lieu de cette position précaire naît une vaste nébuleuse : vérité et illusion, langage et silence, civilisation et barbarie, vie et néant. Charles Marlow, marin britannique comme Conrad, se voit confier le sauvetage de Kurtz, atteint de maladie, membre le plus éminent de la compagnie d’exploitation ; à lui seul, il pu s’approprier une plus grande quantité d’ivoire que toute la compagnie réunie. Kurtz est également peintre, poète, orateur excellent, qualités au service d’un idéal que le roman ne permet de saisir qu’au moyen de conjectures.
En mettant le pied sur le continent africain, Marlow semble déjà projeté de l’autre côté du miroir : des corps noirs amaigris par le travail dûment garanti par les pèlerins coloniaux se propulsent comme des fantômes, quand certains ne connaissent pas leur fin de parcours dans le repos tranquille des hautes herbes, à l’abri du regard et du souvenir. L’étrangeté de la scène, relevé par l’exotisme du territoire dont la définition est assaillie par un brouillard continuel, n’ira qu’augmentant selon la progression du vapeur remontant le fleuve. La tentative de transmettre les phénomènes perçus par Marlow au reste de l’équipage – nous écoutons le récit du marin depuis l’oreille d’un matelot des années plus tard – bute irrésistiblement contre une frontière qui peut être celle du langage lui-même, dans la mesure où il est certes livré à l’horreur concrète, mais plus encore à l’abîme spirituel. Dans cette géhenne coloniale, les oripeaux de l’humanité civilisée ne savent plus cacher l’aspiration secrète des hommes. La présence belge au Congo s’érige comme l’hétérotopie d’une révélation à l’égard de laquelle ni les administrateurs, ni les directeurs de la compagnie, ni même Marlow ne semblent capables d’admettre. C’est pourquoi le capitaine du vapeur chargé de retrouver Kurtz – c’est Marlow – trouve malgré tout une sincère estime pour ce dernier : « C’est pourquoi j’affirme que Kurtz était un homme remarquable. Lui avait quelque chose à dire, et il l’a dit. Depuis que j’ai eu moi-même un aperçu de “ l’autre bord ”, je comprends mieux le sens de son regard, incapable de voir une bougie mais assez large pour embrasser tout l’univers, assez perçant pour embrasser tous les cœurs battant dans les ténèbres. » (p. 174). De la mystérieuse origine dont le langage fait l’épreuve, il aura dit : «“ Cette horreur ! Cette horreur ! ”» (p. 172)
Le roman ne faisant guère de place à sa résolution, ces ultima verba ne peuvent manquer d’interroger. Ils appellent avant tout à chercher Kurtz lui-même : qui est-il exactement ? Quel est cet idéal qui le gouverne si diligemment ? À l’instar de Marlow, nous ne pouvons approcher de la vérité qu’à tâtons. En dépit des obstacles, nous sommes en droit de croire que le personnage de Conrad exprime l’extrême limite d’une certaine conception de la vie sur terre, celle de la pure conquête temporelle, d’un hubris démiurgique. Kurtz paraît être l’artiste intégral, soumettant le monde à toutes ses volontés pour en souffrir la vanité finale. Sans espérer qu’il mettra au jour Le cœur des ténèbres, surveillons à cet égard la parution prochaine du livre en Pléiade, collection nous munissant toujours d’un appareil critique appréciable.
David Labrecque
